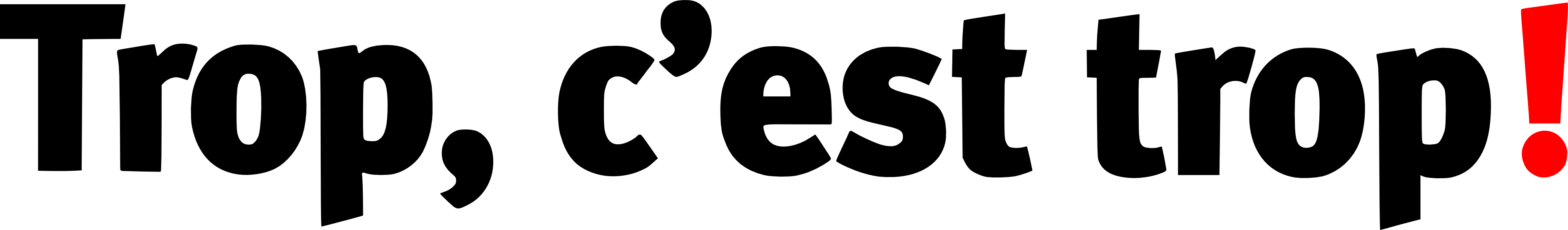par Gilles Manceron
Lorsqu’on se préoccupe de la défense des droits des Palestiniens, une mise au point sur l’antisémitisme et sur les notions de sionisme et d’antisionisme est indispensable, ne serait-ce qu’en raison de l’instrumentalisation par certains de l’accusation d’antisémitisme pour chercher à disqualifier cette défense. Mais la tâche est d’autant plus difficile que la particularité du conflit israélo-palestinien est qu’il se trouve au confluent de plusieurs histoires : l’histoire de l’antisémitisme européen qui a nourri le projet sioniste, celle des ambitions coloniales de l’Europe qui l’a utilisé, et celle du mouvement légitime d’émancipation des peuples colonisés dans lequel s’inscrit la lutte du peuple palestinien. Réfléchir à la question palestinienne aujourd’hui implique de prendre en compte simultanément ces trois histoires.
L’antisémitisme en Europe
Le mouvement en France et en Europe de soutien aux droits des Palestiniens doit faire preuve d’une vigilance particulière vis-à-vis de l’antisémitisme car son enracinement y est multiséculaire. En effet, étant données les persécutions récurrentes que les Juifs ont connues sur ce continent, qui culminèrent avec l’entreprise d’extermination des nazis, la qualification de la civilisation européenne comme « judéochrétienne » est une supercherie. C’est au sein de la chrétienté européenne qu’à partir du Moyen-Age, l’antisémitisme est apparu et s’est développé, même si on a pu trouver dans l’Egypte, la Grèce et la Rome anciennes des traces de judéophobie antiques et pré-chrétiennes. Il s’est manifesté dans l’Espagne wisigothique du VIIe et du début VIIIe siècles où les persécutions antijuives systématiques expliquent le soutien massif des Juifs ibériques à l’invasion arabe de la péninsule en 711.
Dans l’Europe médiévale, le rejet des Juifs reposait sur des raisons religieuses, ceux-ci restant attachés à leurs propres croyances, fêtes et rituels et refusant de se rallier au christianisme dominant. A partir de la première croisade, marquée dès son début par des pogroms contre les Juifs de Rhénanie, les actes de violence dirigés délibérément contre les Juifs se sont multipliés, ceux-ci étant considérés comme des mécréants, des blasphémateurs et des impies au même titre que les musulmans. Ils étaient accusés d’être des « ennemis du Christ », responsables de sa mort, et aussi, à partir d’une première accusation, en 1144, en Angleterre, d’être coupables de crimes rituels, de meurtres d’enfants chrétiens pour consommer leur sang. Le pape Grégoire IX ayant ordonné en 1239 la destruction du Talmud, le roi de France Louis IX (saint Louis) en fit brûler vingt-quatre charrettes en 1242, il imposa aux Juifs le port d’une étoffe de couleur jaune sur le côté gauche de leur vêtement et les obligea à résider dans des ghettos. Les Juifs ont été expulsés d’Angleterre en 1290 et de France en 1306. Ils le furent des principaux Etats allemands en 1450. Lors de la Réforme protestante, si certains auteurs ont été intéressés par le judaïsme, Luther s’est lancé à leur égard dans des diatribes d’une extrême violence : les Juifs étaient pour lui « mauvais, toxiques, diaboliques », il appelait à ce qu’on « incendie leurs synagogues » et qu’ils « soient chassés de notre pays ». Sous son influence, leur expulsion des principaux Etats allemands continuera. L’Espagne catholique les chassa à son tour en 1492, en même temps que les musulmans, poursuivant les convertis par le biais de l’Inquisition, ce qui les a obligé à trouver refuge dans des pays arabes et dans l’empire ottoman.
Dans les siècles qui ont suivi le Moyen âge, l’antisémitisme a reculé en Europe occidentale, notamment aux Pays-Bas, en France et en Angleterre (où la pleine égalité n’interviendra qu’en 1858), contrairement au monde orthodoxe, en particulier à la Russie, où les violences envers les Juifs sont restées nombreuses. D’importants massacres y ont eu lieu entre 1648 et 1658. Dans la France du XVIIIe siècle, l’antijudaïsme a diminué avec la baisse de l’influence de l’Eglise catholique (tout en restant vif, par exemple, chez Voltaire) et a débouché sur la reconnaissance de la pleine citoyenneté des Juifs sous la Révolution.
C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que les termes d’antisémite et d’antisémitisme sont apparus, d’abord en allemand, en 1860 pour désigner l’hostilité envers les Juifs, puis repris à leur compte à partir de 1879 par des auteurs antijuifs. Apparus en français en 1881, leurs occurrences se sont multipliées à la fin de la décennie. Leur étymologie reflète la confusion qui régnait alors dans les tentatives de classification des langues et des races, puisque le terme sémite qui désignait un groupe de langues, dont l’hébreu, a été réservé pour désigner les Juifs, le mot antisémite n’étant pas employé pour nommer l’hostilité envers d’autres populations du même groupe linguistique, comme les Arabes. Quoi qu’il en soit de cette étymologie peu satisfaisante, ces termes se sont imposés, en français comme dans d’autres langues européennes, avec cette signification spécifique : le mot antisémitisme prenant le sens d’antijudaïsme, de judéophobie, ou de racisme à l’égard des Juifs.
Au XIXe siècle, de nouveaux préjugés antijuifs se sont ajoutés à ceux entretenus par l’Eglise catholique, y compris au sein du mouvement ouvrier et socialiste, utilisant la réussite dans la banque et le commerce d’un petit nombre de Juifs pour stigmatiser l’avidité financière des Juifs, la « juiverie » étant chez certains auteurs associée au capitalisme. Avec Edouard Drumont (1844-1917), une nouvelle mouture d’antisémitisme est apparue : dans son best-seller, La France juive (1886) et son journal, La Libre Parole, il a repris la vulgate catholique tout en y ajoutant du nationalisme et de la démagogie plébéienne. Le discours visant le Juif « exploiteur » s’est répandu dans le monde ouvrier, jusqu’à ce que, lors de l’affaire Dreyfus (1894-1906), les principaux leaders socialistes, dont Jaurès, s’en soient démarqués et l’aient rejeté comme un détournement et une perversion des aspirations ouvrières.
La naissance du mouvement sioniste
En Russie, jusqu’à la chute de l’empire tsariste, les violences antisémites n’ont jamais cessé. Des pogroms ont eu lieu à Odessa en 1821, 1849, 1859 et 1871. En 1881, dans deux cents villes et villages russes, des Juifs sont tués, lynchés, leurs maisons et commerces pillés. Peu après, un numerus clausus drastique a été instauré dans les écoles et les universités. C’est le début d’un exode massif des Juifs de Russie — 2,5 millions de départs entre 1881 et 1914 — principalement vers les Etats-Unis, seuls moins de 1% se dirigeant vers la Palestine, qui fait partie de l’empire ottoman. Commence aussi l’exil des Juifs de Roumanie puisque l’indépendance de ce pays et de la Serbie en 1856 fait que les Juifs y ont perdu la protection ottomane. Dans l’empire d’Autriche-Hongrie, l’antisémitisme est puissant, seuls les Juifs ottomans ayant, jusqu’en 1860, le droit de résider à Vienne. Il se manifeste aussi en Allemagne où, en 1880, les associations étudiantes décident de ne plus accepter de membres juifs. La Palestine ne compte alors qu’environ 15 000 Juifs pour plus de 400 000 habitants, mais l’année 1882 marque pour elle le début d’une émigration juive, avant même que ne naisse le mouvement sioniste.
C’est en 1897 qu’apparaît le sionisme, mouvement nationaliste juif, à l’initiative du journaliste juif de Vienne, Théodore Herzl (1860-1904). Alors que le judaïsme est une religion qui s’est propagée après la fin du royaume de Jérusalem au Ier siècle, mais aussi à partir d’autres communautés juives à Babylone, Rome, Cyrène et Carthage, par la conversion de diverses populations locales — notamment chez les berbères d’Afrique du nord et les Khazars de la région de la Volga, au nord du Caucase —, le sionisme invente la notion d’un « peuple juif » ayant une généalogie commune, qui descendrait des habitants de la Judée du Ier siècle contraints à la dispersion et à l’exil. Cette conception généalogique et ethnique du judaïsme qui fait écho à la conception de la nation des penseurs du nationalisme allemand du XIXe siècle, comme Herder, a débouché notamment sur l’hostilité du mouvement sioniste jusqu’en 1914 aux mariages des Juifs avec des non-juifs. Dans cette logique, il a principalement cherché le soutien de l’empire d’Allemagne, alors même que, comme nous l’avons vu, l’antisémitisme s’y développait. Cette conception d’un « peuple-race », tournant le dos à la conception juridique et non ethnique de la nation, issue notamment de la Révolution française, a servi de base au projet de rassemblement des Juifs sur un même territoire, dans un Etat qui serait le leur. Elle a conduit Herzl à combattre le modèle républicain français, de « réponse à l’antisémitisme » par l’acquisition de l’égalité constitutionnelle. Un modèle dont il a prétendu que l’affaire Dreyfus marquait l’échec. Envoyé par son journal viennois à Paris, il écrit : « Le peuple français, en tout cas sa grande majorité, ne veut pas que les droits de l’homme s’étendent aux Juifs. L’édit de la Révolution a été révoqué ». A l’inverse, les Juifs français engagés dans l’Affaire n’ont pas suivi Herzl. Joseph Reinach, par exemple, considérait que Herzl tombait dans « un piège tendu par l’antisémitisme » : « Nous sommes Français, nous resterons Français. Tous nos efforts, toute notre activité intellectuelle, tout notre amour, la dernière goutte de notre sang, appartiennent à la France, à elle seule. » La lecture de Herzl de l’affaire Dreyfus a été contredite par l’histoire, puisque les dreyfusards ont atteint leur but et cette crise a été l’occasion pour la République d’approfondir l’idéal d’égalité de la Déclaration des droits de l’homme en rejetant toute discrimination ou inégalité de race. Par ailleurs, le récit de Herzl attribuant à l’Affaire la naissance en lui de l’idée du sionisme est entièrement inventé et reconstruit, puisqu’il avait, en réalité, déjà formé et défendu ce projet avant l’Affaire1.
Par ailleurs, le sionisme est un cas très particulier de nationalisme puisqu’il n’a pas pour objet de libérer un territoire sur lequel vivent les gens qui s’en réclament, mais qu’il a cherché pour les Juifs dispersés dans différents pays un territoire où ils pourraient se rendre pour construire un Etat. La question de la localisation de celui-ci n’a pas été immédiatement tranchée. Herzl a d’abord cherché l’appui du sultan Abdulhamid II pour l’installer en Palestine — en promettant de lui obtenir un appui financier et même de contrer en Europe les dénonciations des massacres de populations arméniennes qu’Abdulhamid avait organisés en 1895… Puis, n’obtenant ni l’appui ottoman longtemps escompté pour la Palestine ni celui de l’empire d’Allemagne, il s’est tourné vers d’autres soutiens et d’autres lieux d’implantation, Chypre, le Sinaï ou l’Ouganda, en cas d’appui de la Grande Bretagne, ou la Lybie en cas de soutien de l’Italie. On a tendance à oublier que, de ses débuts à 1917, le mouvement sioniste s’est d’abord appuyé sur l’Allemagne et la Turquie ottomane. Théodore Herzl a accompagné Guillaume II lors de son voyage officiel à Istamboul en 1895 et, dans leur recherche d’un appui turc, les sionistes de Palestine n’ont pas soutenu ni accueilli les Arméniens victimes de massacres de 1915. De la même façon, le mouvement sioniste a cherché à dissuader les Etats-Unis à entrer en guerre contre l’Allemagne dans la Première Guerre mondiale. C’est pour contrer ses efforts diplomatiques que Victor Basch a été envoyé en mission officielle par la France aux Etats-Unis pour les inciter à entrer en guerre du côté de l’Entente. Mais, finalement, après l’éclatement de l’empire ottoman, le mouvement sioniste a obtenu en 1917 l’appui britannique pour l’installation d’un « foyer national juif » en Palestine, par une déclaration du ministre des Affaires étrangères, Lord Arthur James Balfour — un aristocrate assez antisémite qui ne voulait pas d’émigration juive en Angleterre…
Si le projet sioniste a pu obtenir ce soutien britannique en 1917, c’est parce que des courants chrétiens issus de la Réforme l’avaient, dès le début du XXe siècle, vu favorablement car ils le percevaient comme pouvant faire revivre en Palestine l’histoire biblique à laquelle ils étaient attachés. Aujourd’hui encore aux Etats-Unis ce sont des courants chrétiens, évangélistes et conservateurs, qui sont les principales composantes du « lobby pro-israélien », alors que beaucoup de Juifs américains s’en tiennent à distance. C’est aussi parce qu’un courant du sionisme, animé par Zeev Jabotinsky, nationaliste de droite, a fait le choix de combattre durant la Première Guerre mondiale avec les Britanniques contre les Turcs au sein de plusieurs bataillons juifs — où s’est battu aussi David Ben Gourion. Or, dès la fin de 1917, une bonne partie de la Palestine est tombée aux mains des Britanniques. Ce courant nationaliste de Jabotinsky, violemment anti-arabe et favorable à un Etat juif sur l’ensemble de la Palestine mandataire, quittera en 1935 l’Organisation sioniste mondiale en opposition avec la gauche qui dominait alors le mouvement sioniste.
Après la Grande Guerre, malgré le soutien du mandat britannique, le nombre de Juifs en Palestine n’a pas augmenté considérablement dans les années 1920, passant de 83 000 en 1922 à 174 000 en 1931. Et, jusqu’à la Seconde guerre mondiale, le courant sioniste est resté minoritaire dans la population juive d’Europe, la plupart des courants politiques en son sein rejetant son nationalisme étroit ou sa compromission avec l’impérialisme britannique. Quant aux religieux, dans leur immense majorité, ils s’y opposaient car le retour à la « terre promise » ne devait se produire qu’après la venue du Messie.
Le terme sioniste, du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, n’a cessé de recouvrir des idéologies et des projets différents. Dans les trois premières décennies du siècle, certains Juifs français comme Victor Basch, président de la Ligue des droits de l’homme de 1926 à 1944, soutenaient le sionisme dans la mesure où ils y voyaient une solution pour les Juifs persécutés dans les pays où sévissaient les pogroms et qui avaient du mal à émigrer en Europe occidentale ou en Amérique. Alors que, pour les principaux théoriciens du sionisme, il s’agissait de rassembler tous les membres dispersés du « peuple juif », qu’ils soient ou non discriminés. Par ailleurs, né lors de l’apogée des empires européens, le sionisme se situait très majoritairement dans « l’univers mental » colonial. Pour la plupart, les immigrants venus d’Europe reprenaient à leur compte le discours dominant du moment par rapport aux indigènes. Afin de justifier son projet, Herzl écrivait, par exemple : « Pour l’Europe, nous formerions là-bas un élément du mur contre l’Asie ainsi que l’avant-poste de la civilisation contre la barbarie ». Et l’un de ses proches, Nordau : « Nous voulons étendre à l’Euphrate les limites de l’Europe ». Lors de l’exposition coloniale internationale de Paris en 1931, un Pavillon de Palestine présentait le projet sioniste. Mais si une partie des sionistes considéraient la Palestine comme « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », et ne prêtaient pas attention à la population palestinienne musulmane et chrétienne habitant ce territoire avant l’arrivée des Juifs d’Europe, d’autres regardaient en face la réalité d’un pays déjà habité par des Arabes palestiniens et envisageaient son partage avec eux, sous la forme d’une « confédération judéo-arabe ».
A partir de 1933, les persécutions nazies ont provoqué un fort accroissement de cette émigration, mais, confrontés à la grande révolte arabe de 1936-1939, les Britanniques, avec leur Livre Blanc de 1939, ont limité l’immigration juive à 75 000 personnes sur une durée de cinq ans, pour que la population juive ne dépasse pas le tiers de la population du pays — au moment même où de nombreux Juifs fuyant le Reich cherchaient une terre d’accueil. Celle-ci a repris au lendemain de la libération des camps en 1945. D’autant que les pays d’Europe centrale et orientale comme la Pologne, les pays baltes et la Roumanie, ne voulaient plus des rescapés de la Shoah — des pogroms y ont eu lieu après la fin de la guerre — et que les pays d’Europe occidentale et d’Amérique étaient réticents à les accueillir. Le résultat est que le recensement de 1947 dénombre 460 000 Juifs en Palestine, soit environ un tiers de la population, le nombre des Arabes palestiniens ayant connu de 1931 à 1947 un accroissement bien moindre, puisque leur nombre est passé de 780 000 à 1 070 000. De 1944 à 1948, les organisations armées juives ont déclenché une guerre qui conduira à la mort de plusieurs milliers d’Arabes, plus de 300 britanniques, ainsi que plusieurs dizaines de Juifs.
La défense des droits des Palestiniens
Avec la création en 1948 de l’Etat d’Israël en Palestine, on peut considérer que le mouvement sioniste a atteint son but, la création d’un Etat juif. Pour les Palestiniens, ce fut au prix d’une catastrophe, la Naqba, qui a conduit à l’expulsion, à partir de plus de 400 villes et villages, de quelque 700 000 d’entre eux lors d’opérations militaires au cours desquelles plusieurs dizaines de massacres de populations civiles ont eu lieu. Le sionisme est devenu l’idéologie officielle du nouvel Etat et la plupart des Israéliens attachés à la défense d’Israël s’en revendiquent explicitement. Mais le terme sioniste est employé dans des sens différents. L’Etat d’Israël considère officiellement ses frontières comme provisoires et la plupart des forces politiques veulent, au nom du sionisme, les étendre au-delà de celles de 1967, à la Cisjordanie. D’autant que les fondateurs de cet Etat comme David Ben Gourion n’ont jamais dessiné la carte de l’Etat juif qu’ils ambitionnaient, et que Jabotinsky voulait l’étendre jusqu’à la rive orientale du Jourdain. D’autre part, les courants ultra-religieux qui se définissaient auparavant comme antisionistes s’en revendiquent aujourd’hui. Mais certaines forces politiques favorables à l’évacuation des territoires palestiniens occupés en 1967 s’en réclament également, faisant valoir que le sionisme d’avant 1948 ne revendiquait pas ces territoires. Dans le judaïsme du monde occidental, même ambigüité. Le terme est revendiqué par les organisations attachées à la défense de l’Etat d’Israël, et surtout celles qui soutiennent les politiques de colonisation des gouvernements israéliens, mais il n’est pas récusé par certaines de celles qui s’opposent à la colonisation des territoires palestiniens occupés en 1967. Et l’ambigüité du terme sioniste qu’on constate chez ceux qui s’en réclament se retrouve aussi chez ceux qui déclarent le combattre. Parfois, ce sont tous les Israéliens juifs, ou tous les défenseurs de l’existence d’un Etat israélien, quelles qu’en soient les frontières, qui sont qualifiés de sionistes. Parfois ce sont uniquement ceux qui veulent étendre les frontières d’Israël de la Méditerranée au Jourdain qui sont ainsi qualifiés, et non pas ceux qui sont favorables à l’établissement d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Pourtant, certains de ces derniers se réclament parfois du sionisme.
Durant les trente dernières années, quelques 900 000 personnes ont émigré en Israël venant d’ex-Union soviétique, en partie poussés par l’antisémitisme persistant dans ce pays. Celui-ci avait été relancé en 1948 lors de la campagne « anti-cosmopolite » qui a culminé en 1952-53 avec le prétendu « complot des Blouses blanches », et il s’est prolongé sous couvert d’« antisionisme » dans les années 1970 et 1980. Lors de l’effondrement de l’URSS, la plupart des Juifs ont quitté le pays en crise quand l’opportunité d’émigrer en Israël a été rendue possible au milieu des années 1980 dans le contexte d’une négociation avec le président américain Reagan. Beaucoup sont allés aux USA et au Canada, mais une partie est venue en Israël et a été orientée vers les colonies de Cisjordanie.
Le sionisme n’a cessé de se nourrir de l’antisémitisme européen et il a une triple nature. C’est un mouvement nationaliste européen au moment où ont émergé en Europe de multiples autres nationalismes, et il partage les ambigüités et la diversité interne de tous les autres nationalismes : du nationalisme de protection et de défense, au nationalisme expansionniste et conquérant. C’est aussi un mouvement qui s’inscrit dans le contexte de la colonisation européenne outre-mer. Et c’est surtout un mouvement qui a été nourri par les persécutions antisémites, n’a pas été suffisamment « désamorcé » par des réactions démocratiques comme celle du mouvement dreyfusard en France en 1894-1906, et un mouvement qui a proposé un refuge aux survivants de ces persécutions à un moment où la plupart des Etats développés ne voulaient pas les accueillir. Avant 1940, le Bund était une grande organisation juive antisioniste. Aujourd’hui, à part « La paix maintenant » venu du sionisme de gauche, la plupart de ceux qui défendent les droits des Palestiniens sont anti-sionistes. Ils refusent non seulement l’annexion et l’occupation, mais aussi la discrimination des citoyens israéliens non-juifs à qui une allégeance à l’Etat juif est demandée, et la discrimination des immigrants en fonction de leur origine « ethnique ». Mais, compte tenu du contexte historique européen complexe dans lequel le sionisme s’est développé et de la polysémie forte et contradictoire de ce terme, l’utilisation du mot sionisme dans la défense des droits des Palestiniens risque d’apporter davantage de confusion que d’éclaircissement. Sauf à préciser qu’on limite son sens à l’idéologie officielle, nationaliste, expansionniste et « ethnique » de l’Etat d’Israël, qui est omniprésente dans les écoles, à l’armée et dans toutes les administrations.
Cependant, quel que soit le jugement qu’on peut porter sur le mouvement sioniste, il a eu un effet : la constitution d’un Etat et d’un peuple. Même si la thèse sioniste d’un peuple juif, « peuple-race » multimillénaire, est une fiction, l’existence d’un peuple israélien est aujourd’hui une réalité. Une réalité problématique, car tout indique qu’il se réduit aux Juifs israéliens et que les 20% de non-juifs en Israël n’appartiennent ni au peuple israélien ni à la nation israélienne. Les partis représentant cette minorité palestinienne arabe sont présents à la Knesset, mais ils ne se sont pas favorables à un Etat juif et restent en marge de la société comme de la vie politique israélienne.
Mais, compte tenu de l’existence de ce peuple juif israélien, dont les Palestiniens sont conscients, défendre les droits des Palestiniens, ce n’est pas proférer contre l’existence de l’Etat d’Israël des discours plus radicaux que ceux des Palestiniens eux-mêmes. La modification par l’OLP, en 1996, de sa charte qui visait la destruction d’Israël reste un fait fondamental, même si l’application des Accords d’Oslo n’a conduit qu’à une extension de la colonisation et une aggravation du sort des Palestiniens. Même si la construction d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale paraît s’être éloignée sans cesse dans les faits durant les deux dernières décennies, cet objectif reste la seule perspective pouvant mettre fin au conflit. Non seulement la France doit reconnaitre cet Etat, mais elle doit militer activement pour que des pressions amènent Israël à accepter cette issue. Elle doit tout faire pour que le respect du droit international lui soit imposé, ce qui implique en particulier de demander aujourd’hui que l’Europe suspende son accord d’association avec l’Etat d’Israël.
Quant à l’antisémitisme, les mouvements de défense des droits des Palestiniens doivent prendre garde à ses possibles résurgences au prétexte de ce conflit. Comme l’a souligné Maxime Rodinson, il n’y a pas d’antisémitisme en soi, d’antisémitisme éternel, mais des formes diverses d’un antisémitisme éminemment évolutif et d’une extraordinaire plasticité. Profondément enraciné dans la longue histoire de l’Europe chrétienne, il repose sur un épais substrat et sait resurgir sous des habillages nouveaux. Il a tendance à se compliquer aujourd’hui du fait de l’interférence de préjugés judéophobes issus des cultures populaires de pays musulmans et de l’immigration qui en provient. Et on constate aussi que des élites et des forces politiques du monde arabe, musulman ou chrétien, ont repris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des écrits européens antisémites — comme le Protocole des sages de Sion — ou négationnistes. Contrairement à l’Europe, il n’y a pas eu dans le monde arabe de haine des Juifs multiséculaire et exterminatrice, mais on a vu apparaître des discours de haine de plus en plus virulents, propagés notamment par certains courants salafistes. Les Palestiniens sont restés jusqu’à une date récente relativement épargnés parce qu’ils ont face à eux un ennemi bien identifié comme israélien. Tout en combattant les théories selon lesquelles un « nouvel antisémitisme » d’origine musulmane se serait substitué en France au « vieil antisémitisme » européen, une réflexion sur ces phénomènes complexes doit être menée. Car, en refusant, bien entendu, l’accusation d’antisémitisme à l’égard de toute critique à l’encontre de la politique de l’Etat d’Israël, il faut aussi prendre garde à ce que des discours « antisionistes » ne soient pas un habillage nouveau pour des propos antisémites.